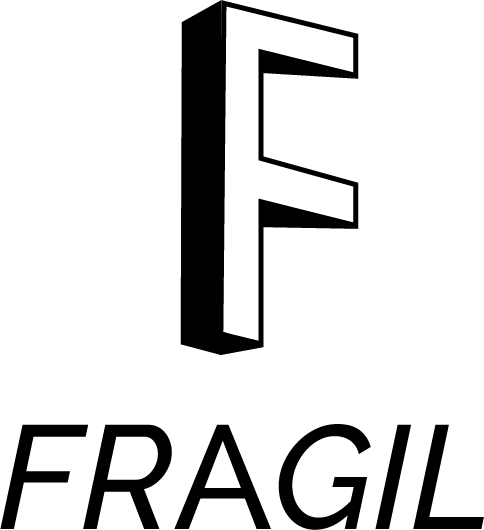En toile de fond, la baie de Morlaix. Des vacances en famille. Et un élément perturbateur, préfiguré sur le drap de rétroprojection par un crabe évoluant dans les eaux des côtes finistériennes : un cancer. Jean-Philippe Davodeau, auteur, metteur en scène et interprète de ce «docu-théâtre», tel qu’il l’appelle, nous livre dans Temps mort une part de lui-même, et de celles et ceux qui ont entouré sa mère Martine pendant son combat contre la maladie. Faire une fiction théâtrale de ce moment de son existence familiale lui permet de prendre le temps d’appréhender ce qui leur est arrivé (à tous·tes, finalement), de créer ce « temps mort », cette bulle temporelle pour reprendre le pouvoir face à la fatalité des événements.
Sur la scène, pas de renforts grandiloquents de décors ni d’excès de pyrotechnie. En tout et pour tout, une chaise, une caméra, un drap, quelques costumes dans la coulisse. L’idée est pour l’auteur de servir le texte au maximum de ses capacités, le plus directement possible. Donner l’apparence du minimalisme pour magnifier le propos, n’offrir que plus de force aux images et, les accompagnant, à l’occasion y apportant un appui supplémentaire, aux mots de leur auteur.
[aesop_image img= »https://www.fragil.org/wp-content/uploads/2022/11/Temps_mort_-_Le_dialogue_entre_acteur_et_ecran-1.jpg » panorama= »off » imgwidth= »50% » credit= »Clémence Llodra » align= »center » lightbox= »on » captionsrc= »custom » caption= »Le spectacle tire sa source d’un documentaire, où la famille Davodeau se livrait durant des vacances, sur les côtes du Finistère » captionposition= »center » revealfx= »off » overlay_revealfx= »off »]
Lui, est seul sur scène, et pour cause. « C’est un projet tellement intime, tellement personnel que la seule forme qu’il pourra connaître, c’est celle avec moi en scène», précise Jean-Philippe Davodeau. «Le film de ma vie se déroule devant moi et je suis son spectateur », ajoute-t-il dans la note d’intention du spectacle. La gestuelle est mesurée, à la recherche d’une émotion sincère. De temps à autre, quand le propos le nécessite, le corps se fond avec les éléments de scène. Le texte est empreint tantôt de tendresse, tantôt de colère, tantôt d’humour. Il se découpe en cinq monologues, entre lesquels s’intercalent des instants choisis du documentaire à la genèse du spectacle.
Le projet au long cours d’un seul en scène familial
Car ce docu-théâtre s’inscrit dans la continuité du documentaire Cet été-là, sorti en 2018, le tout premier réalisé par Jean-Philippe Davodeau. Ce documentaire avait été à l’époque sélectionné notamment pour le Festival de cinéma de Douarnenez, et avait bénéficié d’un bon accueil. Dans ce 32 minutes, dont la substantifique moelle a été reprise au sein de Temps mort, la caméra nous plonge au milieu des roches morlaisiennes, et dans la partie de campagne de la famille Davodeau. Le tout surplombé par l’angoisse de ne pas revoir la famille au complet l’été suivant. « Je ne sais pas si j’aurais eu envie de faire le documentaire s’il n’y avait pas eu cette angoisse-là : potentiellement perdre ma maman », précise son réalisateur. D’où sa volonté de capturer le plus possible de moments de vie, de poser à la famille de multiples questions qu’il regretterait de voir sans réponses si le pire devait se produire (NB. inspiré du questionnaire d’Andreï Tarkovski).
Il ressort de ce documentaire une formidable leçon d’espérance. Une volonté de continuer de partager de bons moments ensemble, de se maintenir en vie malgré tout, d’empêcher l’épée de Damoclès de s’abattre sur Morlaix. On croise tour à tour les portraits de la mère, du père, des enfants, des petits- enfants, de l’arrière-grand-mère aussi, pris·es sur le fait dans des moments volés ou mis en scène par le fils. Un fils quasiment absent du devant de la caméra, un fils qui s’efface pour mettre en lumière ses proches, et sa mère tout particulièrement.
Une fois le documentaire présenté au public, s’est vite fait ressentir le besoin de porter ces images à la scène. L’écriture théâtrale apporte autre chose que le documentaire, elle vient combler la part de non-dit derrière laquelle les Davodeau se protègent encore. Elle permet, par le biais des monologues, de faire évoluer les personnes-personnages hors de leur cadre habituel, de casser le mur de pudeur que la caméra érigeait, malgré les confidences et le caractère vrai des personnages au sein du documentaire. « Le documentaire dit quelque chose de gravé dans le marbre », explique l’interprète. « Le ramener au théâtre, avec une deuxième écriture, permet plus de prise de risques, d’exploser un peu l’intimité, de s’inscrire encore plus fort dans l’impudeur. »
Dans les monologues ainsi formés, l’auteur fait parler les protagonistes de cette épreuve familiale, à savoir la petite fille, le père, le fils, la grand-mère et enfin la mère. À chaque membre de la famille, devenu archétypal par son passage de l’autre côté du miroir diégétique, est associé un mode de discours spécifique, que sont respectivement l’indicatif, l’infinitif, l’impératif, l’interrogatif et le conditionnel. L’exemple le plus criant demeure celui du père, qui énumère à l’aide de verbes à l’infinitif une projection des choses lui restant à faire pour se reconstruire dans l’optique d’un potentiel deuil, au gré d’émotions en montagnes russes.
[aesop_image img= »https://www.fragil.org/wp-content/uploads/2022/11/Temps_mort_-_Le_pere-1.jpg » panorama= »off » imgwidth= »50% » credit= »Catriona Fenwick » align= »center » lightbox= »on » captionsrc= »custom » caption= »Le comédien interprète les membres de sa famille, cassant par-là les parois de l’impudeur » captionposition= »center » revealfx= »off » overlay_revealfx= »off »]
« Redevenir acteur d’une histoire qui est déjà finie »
Gérard Blanc chantait « Et l’on démarre une autre histoire… » en 1986. Temps mort s’inspire de ce créneau, et insuffle en son milieu un moment de légèreté, voire de lâcher prise. Durant le monologue consacré au fils, donc au mode impératif, revient l’idée de la nécessité de se relever de cette épreuve, d’en ressortir grandi et plus fort. Ce faisant, Jean-Philippe Davodeau se lance dans un karaoké survolté de Chante des Forbans, une chanson qui a le double mérite d’être particulièrement entraînante et positive, et d’imposer cette positivité par des paroles introductives à l’impératif : « Chante, chante / Danse et mets tes baskets… ». « Si tout au long de la pièce, plane cette ambivalence entre la volonté de lutter et celle de lâcher prise, on peut dire que son côté universel réside dans le fait qu’elle apporte à l’auditoire quelque chose qui pourrait relever de l’ordre du médicament », avait-il confié à l’occasion d’une représentation au Vallon de Landivisiau (Finistère). Une preuve, s’il en fallait une, que la scène est ici salutaire, et que les proches et les aidants souffrent également lorsque quelqu’un·e tombe gravement malade.
Le corps scénique est libre de ses mouvements, il passe d’un costume à l’autre, du regard innocent de la petite fille qui voudrait aider sa grand-mère à guérir grâce à des super pouvoirs ; au père qui tente non sans peine de trouver dans la foi du sens à ce qui arrive à sa femme ; en passant par l’arrière-grand-mère qui s’interroge à demi-mot sur le pourquoi de cette maladie, étant elle-même de plus en plus concernée par cette problématique. Le corps scénique entre dans le film par ombre chinoise ; il semble, l’espace d’un instant, ne faire plus qu’un avec le drap, comme pour confronter le personnage qu’il incarne et la réalité qu’il se réapproprie. L’auteur a choisi ce biais pour signifier à sa famille sa volonté de « redevenir acteur d’une histoire qui est déjà finie », selon ses termes ; d’en rendre compte, sans doute pour ne pas oublier.
Ce seul en scène a été joué une trentaine de fois, dont 18 fois à Avignon. Plus près, Landivisiau, Rouans (Loire-Atlantique) et Nantes l’ont également accueilli un temps sur leurs tréteaux. Il reste encore trois dates à venir, les 24 et 25 novembre au théâtre du Champ de bataille d’Angers, et le 29 novembre au Jardin de verre de Cholet. Si le spectacle continue de séduire autant le public, venu encourager cette démarche d’intimiser l’universel, d’universaliser l’intime, nous n’avons plus qu’à espérer pour son auteur-metteur en scène-interprète de déborder sur les programmations des saisons 2023-2024. «Tout ça est sur un fil, c’est dur à ce jour de faire exister un spectacle sur plusieurs années », confie Jean-Philippe Davodeau.
Par delà les personnages incarnés sur scène, par delà leur discours sur la maladie, la mort, la gestion du temps qui reste, ces monologues apparaissent comme un hommage à cet enchaînement de solitudes face à l’épreuve qui forment in fine une entité familiale soudée. Une famille unie, réunie autour de la figure de la mère. Plus forte par l’adversité. La plume trempe dans la vérité, elle pousse les cadres étriqués de la parole pudique, tout en laissant poindre l’émotion d’un rapport, plus serein peut-être, avec sa propre histoire, un rapport qui se vit désormais au présent. Le public se tait, reçoit, accepte cette impudeur affichée, réfléchit et vit en simultané avec l’auteur.
L’autofiction génère l’intimité un cran au-dessus du documentaire, en ayant pris le temps de digérer l’angoisse, grâce à la guérison de sa mère (dont l’annonce est portée à l’écran). Celle-ci nous parle d’ailleurs dans un noir final. Comme pour rassurer le public de son aval quant à cette trace de son passage sur Terre. Trace de ses pas, dans le sable de Bretagne, d’ici à ce qu’une mer impétueuse ne vienne bien trop tôt les ensevelir de ses volutes iodées.