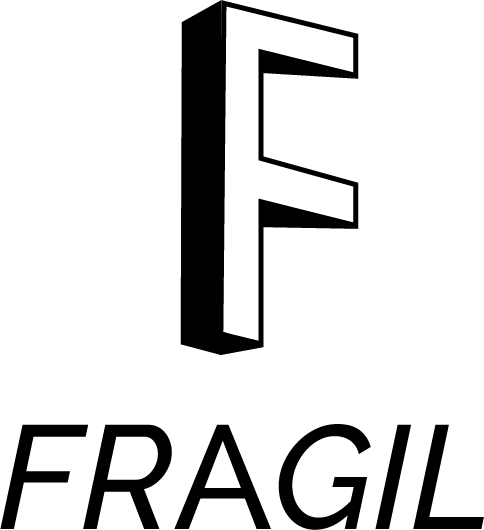Ça fait longtemps que j’habite le même quartier. Plus ou moins au même endroit, et plus ou moins en pointillés, mais c’est « mon » quartier. On le dit chic, on le dit cher, on le dit bien-pensant et cul-béni. J’y vois les agents immobiliers rôder comme des loups en quête de chair fraîche dès que l’un d’eux entrevoit mère-grand quitter sa petite demeure sans espoir d’y revenir.
J’y vois des immeubles aux prestations de « luxe », clapiers pour Parisiens crédules et désespérés de la pâquerette, y pousser comme autant d’amanites phalloïdes, ces champignons si sympathiques en apparence et bien empoisonnés à l’intérieur. Je vois des portefeuilles y investir, se frottant les mains de la défiscalisation à venir, des 4×4 surdimensionnés se mouvoir avec peine dans les rues tortueuses. J’y vois des banderoles à bas prix vanter des pseudo-aménagements hauts de gamme. Roulement de tambour mesdames et messieurs ! Par ici les acrobates de balcon d’1 m2 sur rue, les magiciens-jardiniers de béton, les otaries en nœud papillon glissant sur les sols en faux marbre des halls d’entrée. En quelques années, suivant la tendance, des centaines de bobos bien pensants se sont agglutinés dans ces appartements aux adjectifs ronflants. « Exclusif », « prestigieux », « de haut standing« , « exceptionnel »… mon dictionnaire des synonymes en est vert de jalousie.
Mais au bout de ma rue, une incongrue : lorsqu’une vieille propriété a été remplacée par un de ces rêves de promoteur banal et atone, la maison mitoyenne a survécu. Encaissée, en retrait de la rue et légèrement en hauteur, celle-ci ne fut plus jamais baignée de lumière, coincée entre deux sumos de parpaing creux. L’inhabitable verrue est pourtant restée. Longtemps fermée, puis un jour occupée. Regardant de loin, je me disais naïvement qu’il devait s’agir non pas d’un lieu d’habitation (non, cela me semblait impensable !) mais probablement du siège d’une association, certainement utilisée ponctuellement. C’est dire si ce lieu ne faisait pas de bruit.
Ce jeudi matin, 6 avril 2017, c’est également sans bruit que les forces de l’ordre sont intervenues. Bouclage serré, rue barrée. En toute discrétion, plusieurs fourgons de police accompagnaient quelques messieurs sérieux en pardessus, cartables à la main. Soudain, le film s’est déroulé dans ma tête ; d’un coup, tout s’est éclairci. Assombri, plutôt. J’étais le témoin forcé d’une situation de violence ordinaire. Pire, je réalisais que j’étais riveraine de jeunes qui avaient certainement connu la guerre, la faim et des violences intolérables. J’assistais à l’expulsion d’un squat de mineurs isolés étrangers, dont j’ai appris dans la matinée par la presse qu’il était installé là depuis deux ans. De mon balcon des beaux quartiers, deux ans que je me réjouissais que cette maison ne soit finalement pas tombée, car voir le grand arbre du jardin depuis mon petit chez-moi, c’est quand même pas mal quand je bois mon café dehors !
Alors après ? Se révolter ? Manifester ? S’engager ? Au moins, j’en aurai parlé. Car à défaut d’avoir en soi les ressources pour s’engager dans une association d’entraide, il est de notre devoir de citoyen de ne pas faire comme si les personnes qui vivent à côté de nous n’existaient pas. En cette période électorale qui donne plus de crédit à l’individualisme qu’à la solidarité, un seul mot d’ordre : l’ouverture d’esprit. Celle qui nous fait prendre conscience que nous-sommes-société.
Séverine Dubertrand – avril 2017