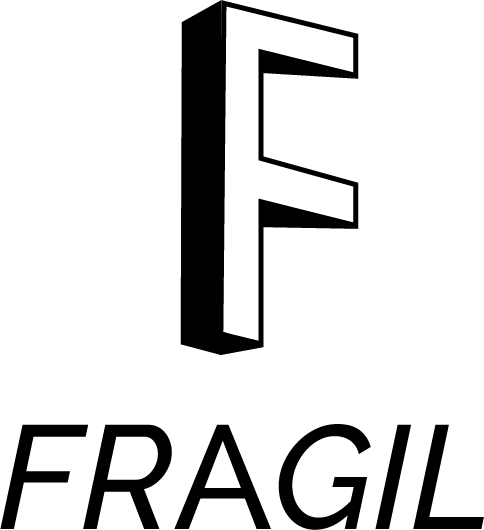Alors que deux expositions londoniennes célébraient en 2000 les cent ans de la mort d’Oscar Wilde, aucun hommage de ce genre n’avait été organisé à Paris, où l’esthète est décédé. Voilà l’oubli réparé par cette grande rétrospective se tenant au Petit Palais jusqu’au 15 janvier 2017 et qui plonge le visiteur, par le prisme Wilde, au cœur de l’époque victorienne.
Rythmée par les aphorismes du dandy anglais, un parfum de douce provocation fin de siècle flotte : « On peut pardonner à un homme de faire une chose utile tant qu’on ne l’admire pas. On n’a d’autre excuse lorsqu’on fait une chose inutile que de l’admirer intensément. Tout art est parfaitement inutile ». Car Oscar Wilde est avant tout un amoureux du beau, lui qui a suivi l’enseignement du professeur John Ruskin. Fervent défenseur des peintres préraphaélites qui se réclament de la moralité des peintres primitifs italiens, et influençant le mouvement Arts and Crafts qui prône un retour à l’artisanat, cet écrivain et critique d’art sera un maître pour Wilde, qui s’entoure des plus belles porcelaines, représente et loue les artistes les plus en vue. A noter l’exposition d’un magnifique portrait de la comédienne Ellen Terry en Lady Mac Beth par John Singer Sargent, prêt de la Tate Gallery et accueillant le visiteur dans un premier espace bleu roi. D’autres œuvres du courant préraphaélite, moins impressionnantes, illustrent la mission critique de Wilde à la Grosvenor Gallery de Londres en 1877 et 1879. Malheureusement sans le Nocturne avant-gardiste de Whistler représentant un feu d’artifice, et violemment esquinté par Wilde (et Ruskin), les Nocturnes « valant certainement la peine d’être regardés aussi longtemps qu’on regarde une vraie fusée, c’est-à-dire un peu moins d’un quart de minute ». Un poète provocateur pourtant réfractaire à une forme de modernité donc.
[aesop_image imgwidth= »1024px » img= »https://www.fragil.org/wp-content/uploads/2016/10/17.A_BEARDSLEY_Salome-gimp.jpg » credit= »Collection Merlin Holland » alt= »Aubrey Beardsley, J’ai baisé ta bouche Ioka-naan, The Studio, n°1, avril 1893. Collection Merlin Holland » align= »center » lightbox= »on » caption= »Aubrey Beardsley, J’ai baisé ta bouche Ioka-naan, The Studio, n°1, avril 1893.
» captionposition= »center »]
Le parcours chronologique réunissant 200 œuvres (manuscrits, photographies, dessins, caricatures, effets personnels, tableaux…) nous mène des États-Unis pour une tournée de conférences, en France. Dans cette dernière section, des éditions dédicacées par Wilde dessinent autour de lui un cercle d’amis parmi l’avant-garde artistique de l’époque : Jacques-Émile Blanche, André Gide, Toulouse-Lautrec, Verlaine, Mallarmé, Hugo…Francophile, Wilde ira jusqu’à rédiger une pièce de théâtre en français, Salomé, censurée à sa publication. L’édition est illustrée par les gravures sèches et sinueuses, délicieusement décadentes, du jeune Aubrey Beardsley, dont 17 planches sont présentes à Paris.
En 1891, l’écrivain entame une relation amoureuse avec Alfred Douglas : des photos de son épouse et de ses enfants côtoient celles de son amant, son cercle d’intimes. Pourtant cette passion amoureuse, outrage aux bonnes mœurs de l’époque, lui vaudra d’être traité au-delà de l’humain, jugé et condamné à deux ans de travaux forcés. C’est ce qu’évoque la dernière partie de l’exposition, au travers d’un précieux témoignage filmé : Robert Badinter remonte aux condamnations réservées aux sorcières sous l’Ancien Régime pour terminer son exposé par le procès et l’incarcération d’Oscar Wilde auquel il consacre la pièce C.3.3.. Et d’asséner : « Toute justice est relative, c’est pourquoi elle ne doit pas attenter à la personne humaine. »
Sandrine Lesage / Octobre 2016