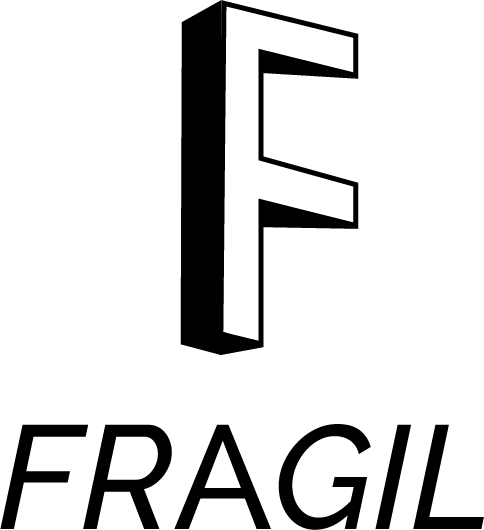Lancé pour la toute première fois à Nantes par l’association PAN!, le festival FilmHer se tenait ce jeudi 27 juin au cinéma Le Concorde. Au cours de l’évènement, une table ronde était animée par la radio Prun’ pour penser les rapports entre genres et cinéma et explorer les questions de représentativité des femmes et minorités de genre dans l’industrie du film.
Selon Joëlle Touïtou Hatton-Brown, fondatrice de l’association PAN! et consultante au sein du cinéma Le Concorde, la représentation des femmes et minorités de genre dans le cinéma progresse mais elle est encore loin d’être suffisante aujourd’hui : « On a toujours l’impression que nos droits progressent, que la visibilité progresse, que l’égalité en école de cinéma ça va mieux. Et puis on se retrouve face aux génériques de films où les équipes sont à 99% masculines, on se retrouve sur des plateaux assez bousculée et l’on se dit que ce n’est toujours pas gagné ».
Malgré les quelques avancées en matière de parité homme-femme dans les écoles de cinéma, la fondatrice de PAN! indique toutefois que le gros du travail en matière d’égalité femmes/hommes et de représentativité des minorités de genre dans le cinéma reste à faire dans les métiers de la production et de la réalisation cinématographique : « Le gap qui s’opère c’est que pour entrer dans l’industrie, pour se professionnaliser et en vivre, là on a une vraie déperdition et on retrouve très peu de femmes« .
Parmi les films français sortis en 2023, seulement 28% ont été réalisés par des femmes et d’après l’étude du collectif 50/50 qui se charge de relever les statistiques d’égalité et de parité dans le cinéma et l’audiovisuel, les réalisatrices travaillent sur des films dont le budget moyen est 34% inférieur à celui de leurs homologues masculins.

Table ronde organisée par l’association PAN, le cinéma Le Concorde et la radio Prun’. De gauche à droite ; la professeure d’études filmiques et américaines Delphine Letort, les réalisatrices Mathilde Profit et Florence Mary ainsi que les deux animatrices de l’émissions.
Manque de légitimité et autocensure, des freins pour les réalisatrices
Interrogée sur les obstacles qu’elle a pu rencontrer au cours de sa carrière dû à son genre, la réalisatrice Mathilde Profit, explique cela par le sentiment de manque de légitimité qu’éprouvent de nombreuses femmes dans les métiers du cinéma : « C’est une chose que l’on retrouve chez plein de cinéastes femmes, qui en fait ne s’y mettent pas tout de suite pour plein de raisons. Moi par exemple je ne me sentais pas légitime donc c’est une sorte de frein que j’ai intégré, car on ne m’a jamais obligée. J’ai fait des études de cinéma qui m’auraient permis de dire que je peux faire des films à 18, 20, 22 ans, j’aurais pu me le dire tous les jours. Mais je pense que j’ai intégré mes propres freins dans ma manière d’aborder l’écriture, donc quelque part, le plus gros frein c’est moi qui l’ai posé« .
D’après la cinéaste, il existe une forme d’autocensure extrêmement forte chez les femmes réalisatrices qui peut contribuer au manque de représentativité dans le métier. « Lorsqu’on est une femme on est plutôt éduquée à ne pas écouter notre voix intérieure et à plutôt la garder pour soi, indique Mathilde Profit c’est plutôt une méthode de survie en fait, on se dit qu’on va gagner une meilleure place si on ne dit pas ce qu’on pense au fond, d’ailleurs c’est comme ça que moi j’ai eu mes concours, en m’adaptant et faisant ce qu’on attendait de moi. Ce qui est fou et je le vois tous les jours, on a intérêt à avoir envie 1000 fois plus fort qu’un homme, parce qu’il n’y a que nous qui nous donnons la possibilité d’exister« .
Dès les années 1970 des voix commençaient à se lever contre la sous-représentation des femmes dans le cinéma et le concept de Male gaze (« le regard masculin » misogyne) était développé par la critique de film Laura Mulvey dans son article Visual Pleasure and Narrative in Cinema (1975). Selon Delphine Letort, professeure d’études filmiques et américaines à l’université du Mans Delphine Letort présente lors de la table ronde, « même si les réalisatrices sont des femmes, cela ne veut pas dire qu’elles changent complètement la manière de filmer des femmes, tout simplement parce qu’on a internalisé des décennies de films et de manières de regarder la femme. » Le changement de représentation des femmes devant la caméra se joue aussi dans l’éducation « il faut apprendre à voir et à regarder autrement et il y a un travail à faire sur cette question-là » confie la chercheuse.