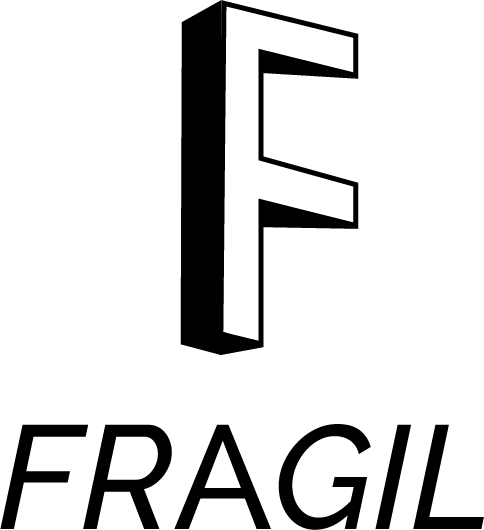Falstaff (1893), présenté au festival de Saint-Céré en 2015, trouve sa source dans une comédie de Shakespeare, Les joyeuses commères de Windsor. Ainsi, six ans après le très sombre Otello, également inspiré d’une pièce du dramaturge anglais, Verdi choisit, pour son chant du cygne, un registre plus léger. Durant toute sa carrière, il n’a cessé de sublimer, par le chant et le théâtre, une douleur qui se décline en trahison, solitude, méprise ou désillusion.
[aesop_quote type= »block » background= »#ffffff » text= »#000000″ align= »center » size= »1″ quote= »Durant toute sa carrière, Verdi n’a cessé de sublimer, par le chant et le théâtre, une douleur qui se décline en trahison, solitude, méprise ou désillusion » parallax= »off » direction= »left »]
Les hasards de sa biographie expliquent certainement des résonances que l’on trouve d’une œuvre à l’autre. A la suite de la perte de ses propres enfants, Giuseppe Verdi a notamment développé, de manière obsessionnelle, le thème de la paternité meurtrie. Les pères en souffrance ou en conflit se succèdent et ont pour noms Nabucco, Germont, Rigoletto ou Philippe II. Falstaff est l’histoire d’un bon vivant qui se fait duper par deux femmes et se retrouve pris au piège de désopilantes mystifications. C’est aussi une œuvre qui montre que l’amour peut être frivole. Elle s’achève sur une leçon de vie qui témoigne du chemin parcouru par le compositeur, vers une sérénité retrouvée. L’ensemble final reprend en un écho joyeux le constat plein de sagesse de celui qui vient d’être berné, « le monde entier est une farce ». Verdi quitte la scène en un vibrant paradoxe : son dernier coup de théâtre.

Falstaff, opéra de Verdi de 1893, était présenté au festival de Saint-Céré en 2015.
Un changement de regard
Sir John Falstaff est un épicurien qui vit dans l’instant et aime avant tout bien boire et bien manger. Ce personnage irrévérencieux et truculent incarne une rupture radicale avec la gravité bouleversante d’autres figures inventées par Verdi, et habituellement placées au centre de ses opéras. Le farceur ne peut payer sa note à l’auberge et écrit deux lettres d’amour identiques à deux bourgeoises, Alice Ford et Meg Page. La manœuvre, par-delà la tentative dérisoire de séduire encore, est avant tout destinée à trouver de l’argent. Les deux femmes comparent les missives et décident de prendre au piège celui qui s’est moqué d’elles. La vengeance explose en farce. Invité par Alice, l’arroseur arrosé se retrouve, après l’arrivée du mari, dans un panier de linge que l’on jette dans la Tamise.
[aesop_quote type= »block » background= »#ffffff » text= »#000000″ align= »center » size= »1″ quote= »La vengeance explose en farce. Invité par Alice, l’arroseur arrosé se retrouve, après l’arrivée du mari, dans un panier de linge que l’on jette dans la Tamise » parallax= »off » direction= »left »]
La légèreté devenue possible s’imprime aussi dans les amours de Fenton et de Nanetta. Leur histoire n’a rien de tourmenté ni de vraiment impossible et Verdi a composé quelques pages lumineuses pour de courts duos aux aigus extatiques, et particulièrement sur une rencontre sous la lune, d’une beauté irréelle. Anaïs Constans et Laurent Galabru apportent à ces rôles juvéniles et insouciants leurs présences poétiques et des timbres remplis de grâce.

C’est aussi une œuvre qui montre que l’amour peut être frivole.
Falstaff était interprété à Saint-Céré pendant l’été 2015, et durant la tournée du spectacle en mars 2016, dans la version française d’Arrigo Boito, librettiste de Verdi pour ses deux derniers opéras, et compositeur génial de Mefistofele (1868). Giuseppe Verdi avait une profonde connaissance de la musicalité et de la respiration de notre langue puisqu’il avait créé deux de ses opéras, Les vêpres siciliennes (1855) et Don Carlos (1867) en français à l’Opéra de Paris. Sa dernière œuvre a été jouée pour la première fois en italien à la Scala de Milan, mais sa traduction par l’auteur du livret lui donne une authenticité et une légitimité. Les mots dessinent de nouveaux contours et imposent d’autres couleurs à la partition, et une théâtralité différente, ce qui contribue à la modification de point de vue sur l’œuvre de Verdi.
Tout s’achève en carnaval
Dans La Traviata, le carnaval ne fait que passer, comme une réminiscence, durant l’agonie finale de Violetta. Il occupe une place centrale dans Falstaff, en enveloppant la frénésie du jeu. Olivier Desbordes épouse dans sa mise en scène le rythme et l’urgence de cette comédie, dans une énergie de tous les instants. Il s’inspire du théâtre élisabéthain en jouant les différentes actions sur des tréteaux, en un permanent effet de théâtre dans le théâtre. On se déguise énormément. Plusieurs personnages d’autres opéras de Verdi sont convoqués dans une confusion des registres. Ford, dans son discours de mari jaloux, prend les airs manipulateurs de Iago dans Otello .

Ce dupeur dupé nous entraîne dans un monde d’apparences fragiles, à la fois insaisissable et porteur d’espoir.
[aesop_quote type= »block » background= »#ffffff » text= »#000000″ align= »center » size= »1″ quote= »Olivier Desbordes s’inspire du théâtre élisabéthain en jouant les différentes actions sur des tréteaux, en un permanent effet de théâtre dans le théâtre » parallax= »off » direction= »left »]
La mascarade fait partie intégrante du livret. Le texte de Shakespeare implique ce plaisir du jeu et avait déjà fait l’objet d’un opéra allemand d’Otto Nicolai, tout aussi réjouissant, Die Lustigen Weiber von Windsor (1849). Mrs Quickly joue un rôle de démiurge en donnant l’invitation d’Alice à Falstaff, et en exagérant de manière obséquieuse le trouble ressenti par celle qui l’envoie. Elle se prosterne sur le mot « Révérence », qui descend dans des sonorités graves et caverneuses pour un bel effet comique. Sarah Laulan insuffle à cette figure un tempérament impressionnant et un bonheur communicatif d’être sur le plateau. Elle participera à un événement en octobre prochain à l’opéra de Rennes : la création mondiale de L’ombre de Venceslao de Martin Matalon, d’après une pièce de Copi, sur un livret et dans une mise en scène de l’immense Jorge Lavelli. Ford a également recours à un travestissement vertigineux, en se présentant sous un faux nom à Falstaff, pour lui demander de courtiser sa propre femme dans le but de mieux l’approcher ensuite. C’est le triomphe d’un théâtre démultiplié !

Dans l’ivresse de cette fin heureuse, Falstaff conclut « le monde entier est une farce », repris en une fugue tourbillonnante par toute la troupe.
Le paroxysme du désordre est atteint dans la scène finale. Falstaff est invité, à minuit, dans le parc de Windsor, qui rappelle à cette heure de la nuit la forêt du Songe d’une nuit d’été. Tous les protagonistes apparaissent costumés en elfes et en lutins, pour forcer le convive indélicat à demander pardon sous l’effet de la terreur. C’est dans ce contexte fantasmagorique que Fenton épouse Nanetta, en triomphant des résistances du père, vaincu par les masques. Ce cadre onirique réserve à Anaïs Constans une mélodie d’une beauté à tomber à genoux, de ces moments qui, à l’opéra, font couler des larmes de bonheur, dans l’envol et la perfection d’une note ineffable.
[aesop_quote type= »block » background= »#ffffff » text= »#000000″ align= »center » size= »1″ quote= »Dans l’ivresse de cette fin heureuse, Falstaff conclut « le monde entier est une farce », repris en une fugue tourbillonnante par toute la troupe » parallax= »off » direction= »left »]
Dans l’ivresse de cette fin heureuse, Falstaff conclut « le monde entier est une farce », repris en une fugue tourbillonnante par toute la troupe. Christophe Lacassagne donne au rôle-titre toute la profondeur de son timbre et construit un personnage exubérant et pétri d’humanité. Un artiste ne nourrit-il pas son interprétation de tous les rôles qu’il porte en lui ? Ce dupeur dupé nous entraîne dans un monde d’apparences fragiles, à la fois insaisissable et porteur d’espoir. Ce magnifique artiste sera Germont dans La Traviata de cet été à Saint-Céré : un rôle énorme, à la mesure de sa sensibilité, après ses incarnations mémorables d’autres pères, dans Rigoletto (2011) et dans Lost in the Stars (2012).
Texte : Christophe Gervot
Photos : Nelly Blaya